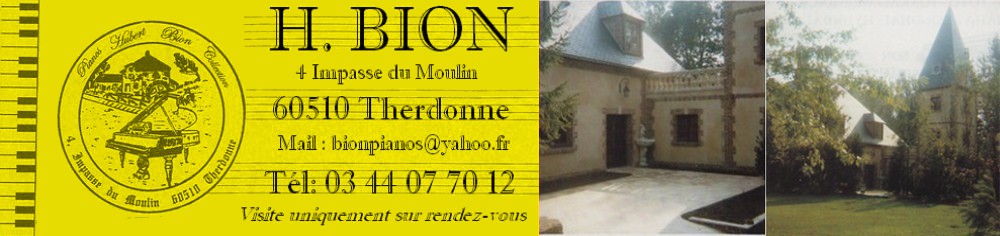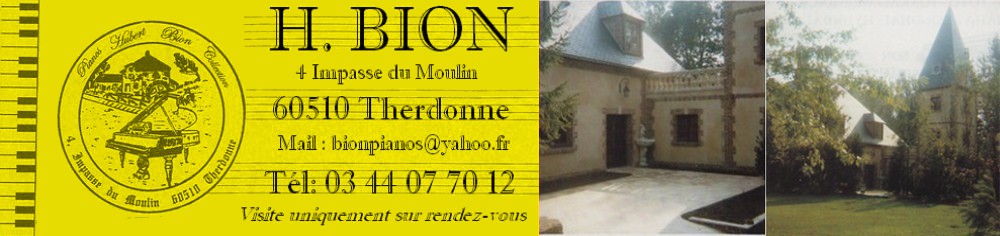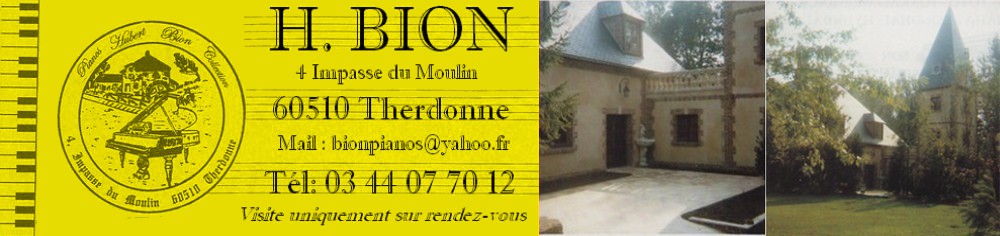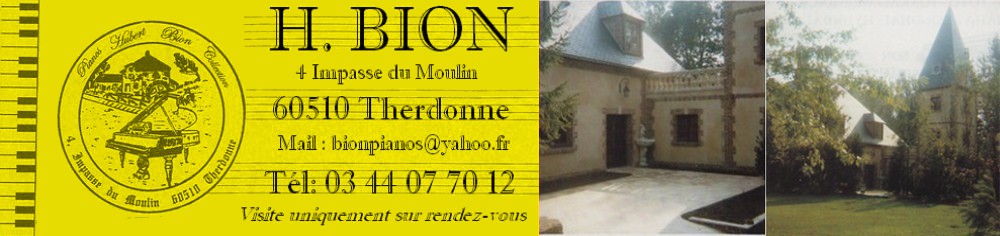Les pianos Gaveau

LA MAISON GAVEAU
Manufacture de Pianos
1847-1971
Fondée à
Paris en 1847 par Joseph Gaveau (1824-1903) la Maison
Gaveau était une des trois grandes marques françaises de
piano – avec la Maison Erard (fondée en 1780) et la
Maison Pleyel (fondée en 1807) – qui ont dominé la vie
musicale française jusqu’au milieu du 20ème
siècle. Elle était arrivée la dernière, elle a pris son
envol à partir du début du 20ème siècle et
c’est avec elle que la grande tradition nationale de
piano a pris fin, un peu plus de cent vingt ans plus
tard.
A l’époque de la
fondation de la Maison Gaveau, les grandes inventions
qui ont façonné l’instrument ont été déjà accomplies. En
effet, c’est dans les années 1820 que furent déposés les
brevets les plus importants qui ont déterminé la
structure de l’instrument moderne.
Ainsi le principe du
mécanisme utilisé actuellement dit « à double
échappement » fut breveté par Erard à la fin de
l’année 1821 à Londres et en début 1822 à Paris.
Ensuite venait en 1825
le brevet du cadre métallique coulé d’une seule
pièce déposé par Babcock à Boston aux Etats-Unis.
Pape est l’inventeur
d’un élément essentiel du piano moderne : les
marteaux recouverts de feutre au lieu de cuir comme
auparavant et le brevet fut déposé en 1826 à Paris.
Le croisement des
cordes des pianos actuels était une idée déjà fort
ancienne. Le piano à ses origines – appelé pianoforte
pour avoir la possibilité de jouer doucement ou fort
contrairement au clavecin – avait comme ce dernier, dont
il avait hérité le dispositif harmonique (mais non pas
la mécanique !), des cordes disposées parallèlement les
unes aux autres. L’idée de faire passer les cordes des
graves par-dessus du médium pour leur donner un peu plus
de longueur (et donc un peu plus de volume sonore) était
appliquée dans les petits pianos carrés déjà tout au
début du 19ème siècle : on la trouve dans des
pianos à bon marché qui étaient un peu méprisé pour leur
sonorité alors considérée comme pauvre. Le brevet fut
déposé par Pape en 1828, également à Paris, cette
fois-ci pour son application dans des petits pianos
droits.
Une trentaine d’années
plus tard, en 1859, Steinway allait breveter aux
Etat-Unis l’idée d’une combinaison du cadre
métallique coulé d’une seule pièce et du
croisement des cordes destinée maintenant au
grand piano à queue de concert et on l’a appelé la
« nouvelle technologie ». Elle allait concurrencer
l’ancienne méthode des cordes parallèles
soutenues par un cadre composite que l’on
pourrait alors appeler la « technologie classique ».
La « nouvelle technologie allait s’imposer et déterminer
l’avenir du piano et profondément modifier la sonorité
de l’instrument, la technique d’exécution ainsi que
l’interprétation pianistique.
La maison Gaveau
n’était donc pas pionnière dans le développement du
piano comme l’étaient ses aînés Erard et Pleyel ; elle
appartenait à cette deuxième vague de grands facteurs de
pianos qui se sont installés à la seconde moitié du 19ème
siècle pendant laquelle l’industrialisation prenait le
pas sur l’artisanat.
Outre le chef de file
de la « nouvelle technologie », Steinway, cette vague
comportait des facteurs très importants tels que
Beschstein et Blüthner en Allemagne (par un curieux
trait du hasard, ces trois sociétés ont été fondées en
1853). Les deux facteurs allemands ont adopté assez
rapidement cette « nouvelle technologie » de Steinway et
ensemble ils en ont fait une promotion d’une telle force
et efficacité que la « technologie classique » (surtout
défendue par Erard en France, par la firme Broadwood
[fondée en 1769)] en Grande-Bretagne et par la firme
Chckering [fondée en 1823] aux Etats-Unis) était
progressivement poussée dans une situation d’infériorité
qui a fini par l’éliminer totalement.
Les deux technologies
ont leurs points forts et leurs faiblesses. La « nouvelle
technologie » donne aux instruments une solidité
exceptionnelle qui permet une tension des cordes extrême
donnant une puissance sonore inégalée mais au détriment
des harmoniques, du timbre. Avec sa sonorité homogène et
immédiatement jolie, plus percutante mais moins
personnelle, le piano moderne est aussi plus
passe-partout que l’instrument classique : il peut
servir (et il sert) pour exécuter la musique de Bach
jusqu’au Jazz.
La sonorité produite
par les instruments construits selon la « technologie
classique », même dans son état le plus évolué, a
des qualités plus variées : elle est plus riche en
harmoniques, plus chantante, plus délicate mais ayant
besoin d’une technique pianistique plus complexe pour
faire ressortir toutes ses possibilités. Ceci va avec
des performances de puissance sonore à peu près
semblables à celles de la « nouvelle technologie » tout
au moins au stade de son développement à cette époque.
On peut constater pour
les deux catégories des dimensions accrues, une grande
solidité, une puissance sonore fortement augmentée
(mais, en ce qui concerne les pianos fabriqués selon la
« technologie classique », sans doute insuffisante pour
les salles surdimensionnées et les orchestres
hypersonores de notre époque, auxquels la « nouvelle
technologie » s’est naturellement adaptée).
Précisons que la Maison
Erard, un des défenseurs acharnés de cette « technologie
classique », a construit dès 1850 des grands pianos à
queues de concert ayant un cadre composite complet,
solide mais assez léger, portés à l’étendu de 90 notes
(au lieu de 88 notes adoptées habituellement) et & l&
longueur de 2m60 (au lieu de 2m40 auparavant) mais, bien
sûr, toujours à cordes parallèles. Ces pianos à queue de
concert ont été qualifiés comme les plus accomplis
jamais construits. Il faut comprendre par là qu’il
s’agit d’un piano équilibré, avec des basses très
présentes et sonores (mais qui ne dominent pas comme
dans des pianos modernes), un médium ayant des timbres
très variés où il est possible de faire mélanges sonores
infinis et dont l’aigu est une peu court mais
scintillant qui complète bien les harmonies de
l’instrument qui a conservé ce halo moiré des anciens
pianofortes.
Il est donc permis
d’admettre que les pianos construits selon la
« technologie classique » après 1850, instruments
solides, ayant une étendue et une puissance sonores
augmentée, et que l’on pourrait appeler des « pianos
classique » pour les différencier des
pianosfortes, plus délicats et fragiles, sont tout
de même plus proche des instruments du temps des
compositeurs dits « classiques » et « romantiques » que
les pianos modernes.
Les cordes parallèles
ont gardé par ailleurs la préférence de certains
compositeurs jusqu’à la première moitié du 20ème
siècle, notamment, de Gabriel Fauré qui a gardé son
quart de queue Erard à Maurice Ravel qui est resté
fidèle à son demi-queue Erard jusqu’à sa disparition en
1937. A l’heure actuelle quelques adeptes rares existent
toujours et qui vont revivre ces « pianos classiques »
de façon très marginale en concert et quelques fois aux
disques.
La Maison Gaveau était
en fait peu concernée par ces rivalités entre la
« technologie classique » et la « nouvelle
technologie ». Au départ elle aurait suivi la grande et
prestigieuse Maison Erard en adoptant les cordes
parallèles. Mais malheureusement peu de documents
peuvent attester avec précision de l’évolution des
pianos de cette marque pendant les premières décennies
qui suivent la fondation : les registres de fabrication
antérieurs à l’année 1908 ont disparu probablement dans
l’incendie qui a ravagé l’usine de Fontenay-sous-Bois en
banlieue- Est parisienne le 12 mars 1908. Il nous reste
les brevets détenus à l’Institut Nationale de la
Propriété Industrielle (INPI). Ceux qui datent de 1880
et de 1883 donnent en exemple des figures qui montrent
les pianos droits à cordes parallèles obliques. Le
passage aux cordes croisées se situerait aux alentours
de l’année 1890. Le catalogue de 1899 montre une
quasi-totale conversion à la « nouvelle technologie ».
L’ascension de la
Maison Gaveau est assez lente, ce que démontrent les
récompenses successives aux Expositions Universelles de
Paris : la médaille de Bronze à celle de 1855, Argent en
1867 et la médaille d’Or en 1878 et en 1889, Gaveau
était hors concours à l’Exposition Universelle de 1900.
Il n’y a pas eu de concerts de représentation avec des
instruments de Gaveau pendant les Expositions
Universelles comme c’était le cas avec des marques
prestigieuses Erard et Pleyel ou encore avec ceux des
firmes alors fort connues telles que celles de Henri
Herz ou Mangeot, ce qui indique que Gaveau n’était pas
encore dans la cour des grands à la fin du 19ème
siècle.
Il est à noter que les
succès obtenus par Steinway et Bechstein furent
immédiats. En effet, les grands virtuoses comme
Paderewski et Anton Rubinstein ont soutenu Steinway dès
le départ et c’est sur un piano de concert de Bechstein
qu’a été créée la sonate de Franz Liszt à Berlin en 1857
(donc 4 ans après la création de la firme et cet
instrument était encore équipé de cordes parallèles). On
a affirmé que Gaveau aurait pris les instruments de
Bechstein comme modèle pour concevoir ses pianos
modernes (et Pleyel se serait tourné vers Steinway).
Le vrai démarrage des
pianos de concert Gaveau se situe en 1903 où pour la
première fois un instrument de cette marque sonne lors
d’un concert avec l’Orchestre Lamoureux : le fait à été
signalé par « la Revue Musicale » du 15 juillet 1903. A
cette époque les pianos à queue de cette firme étaient
tous équipés de cordes croisées et de cadre en fonte ;
pour certains modèles de pianos droits, on pouvait
encore choisir entre cordes croisées et cordes
parallèles et ces dernières étaient parfois tendues sur
un cadre en fonte.
L’ouverture de la Salle
Gaveau en 1907 a confirmé et amplifié le succès de la
marque. Elle était la première vraie salle de concert à
Paris qui peut contenir 1000 auditeurs et elle prenait
tout de suite une place centrale dans la vie musicale
parisienne. On y jouait naturellement sur des pianos de
concert Gaveau mais dans les rares cas les pianistes y
introduisaient d’autres marques – on peut trouver dans
les annales de cette époque quelques Erard ou Pleyel
pour les Français et un rarissimes Steinway pour un
pianiste étranger. Dans ce cas il fallait alors louer
l’instrument ce qui pouvait être très onéreux et donc
dissuasil. Alfred Cortot, par exemple, y jouait sur
Pleyel mais Arthur Rubinstein, encore en début de
carrière, devait accepter (à contrecoeur) le Gaveau
maison.
Il est donc intéressant
de noter que les pianos de la Maison Gaveau ne faisaient
pas l’unanimité, ils avaient leurs supporters mais
également des adversaires farouches. Le fait que la
marque avait été fondée plus tardivement qu’Erard et
Pleyel – qui avaient développé chacune une personnalité
sonore très marquées, fortement liée aux compositeurs et
pianistes du passé – la sonorité des pianos Gaveau
paraissait à cette époque un peu impersonnelle. On a
rapporté que Clara Haskil avait refusé aux années 1920
l’offre très attractive de la Maison Gaveau de la
soutenir dans sa carrière : cependant, bien plus tard,
au Festival de Besançon en 1956, où elle avait accepté
de jouer sur un Gaveau, le témoignage sonore, pris sur
le vif, fait attendre un très beau concert et quelques
fausses notes pour lesquelles le piano n’y était pour
rien.
D’un autre côté,
plusieurs pianistes ont accepté de jouer pour la Maison
Gaveau. En premier lieu Marguerite Long, pianiste -
concertiste et pédagogue célèbre, par exemple. Il y a eu
aussi José Iturbi, un pianiste virtuose très connu
internationalement avant la seconde guerre mondiale qui
faisait des tournées en Asie avec des pianos Gaveau.
(Décédé en 1980 et au moment de la liquidation de son
héritage, son quart de queue Gaveau de 1m77 de long
construit en 1948, qu’il avait gardé, a été mis à prix
aux enchères en Avril 2008 en Californie pour 1 680
dollars au bénéfice de la Fondation Iturbi, le
demi-queue Steinway en valait 16 800…). Il y eu aussi
Georges Cziffra qui collabora même à l’amélioration de
la sonorité des pianos de concert Gaveau (il en a
possédé lui-même un, construit en 1948). Notons
également que deux célèbres pianistes allemands, Wilhelm
Backaus et Wilhelm Kempff, ont joué sur Gaveau et pas
uniquement à la Salle Gaveau. En 1955 Wilhelm Kempff a
accepté de jouer sur un gaveau à Nancy (où l’instrument
avait été loué) et même à l’étranger, à Istanbul (où la
Maison Gaveau avait vendu un piano à queue de concert en
1948).
Comme c’est le cas pour
le pianoforte et le « piano classique », les pianos de
concert de la Maison Gaveau sont actuellement utilisés
sporadiquement pour des enregistrements discographiques
récents et d’une façon marginale mais ceci complète une
discographie d’avant la Deuxième Guerre mondiale et des
deux décennies qui l’ont suivie où les pianos français
ont abondamment servi pour des enregistrements en
France, souvent sans en préciser la marque.
Somme toute, les pianos
de la Maison Gaveau étaient d’excellents instruments,
les exemplaires de pianos de concert restant avec
lesquels sont faits des enregistrements discographiques
récents en témoignent. Pourquoi cette marque a-t-elle
alors sombré, aussi bien qu’Erard et Pleyel ? La réponse
à cette question est difficile à donner et nécessite une
étude plus approfondie. Toutefois, après avoir présenté
des documents que nous avons pu rassembler concernant la
marque et, ensuite, tracé un bref rappel de l’histoire
du piano français, nous allons tenter d’y apporter
l’ébauche d’une explication en plaçant ce naufrage dans
une esquisse du climat musical très particulier dans
lequel il s’est produit.
Pour en savoir plus sur la
prestigieuse maison Erard nous vous recommandons un
livre très bien conçu dont nous vous avons reproduit de
nombreuses pages (le piano Erard d’un millénaire à
l’autre de Jean Jacques TRINQUES l’Harmattan).
L’harmattan
5-7 rue de l’école-Polytechnique
75005 Paris
FRANCE
|