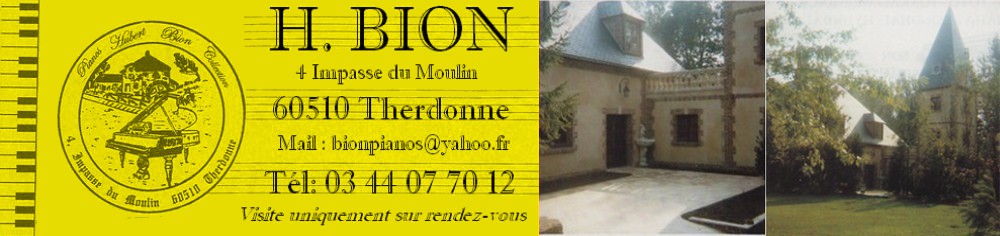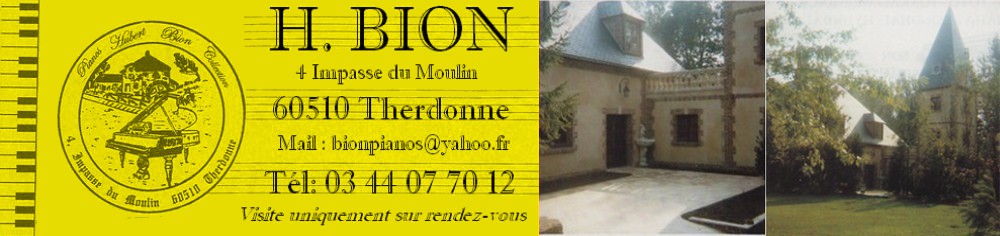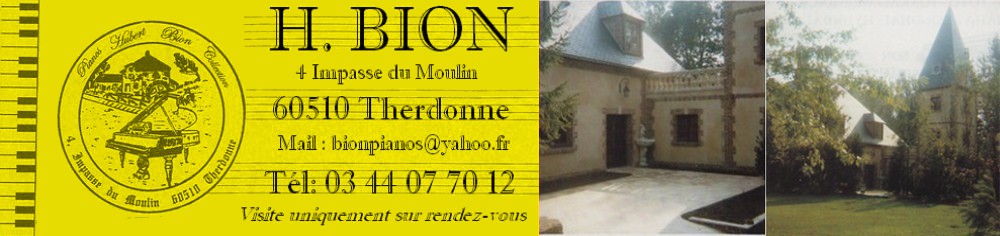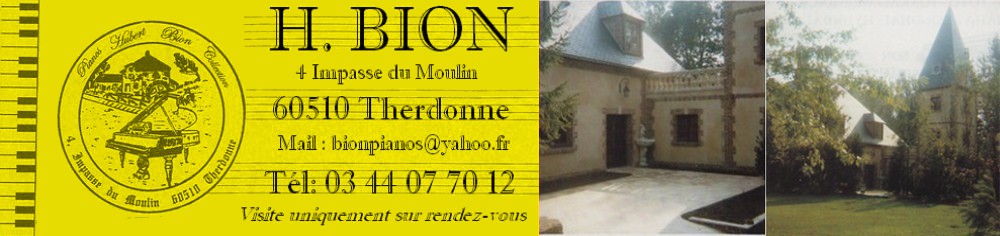IGNACE PLEYEL
Ignace Pleyel ne rêvait-il pas, en
inscrivant son nom au bas de ses partitions, à de plus
belles lettres, des lettres d’or qui illumineraient son
premier pianoforte ?
Le rêve devint réalité. La
réalité devint mythe. Et de briller encore et pour toujours
au firmament de notre facture instrumentale, il n’est dans
le domaine de plus grande et pathétique histoire. Une
aventure industrielle, humaine, sociale.
Du petit atelier parisien
du boulevard Bonne-Nouvelle à l’usine moderne d’Alès, nous
vous invitons, pour l’entame de ce troisième millénaire, à
la découverte de l’un des plus beaux fleurons de notre
patrimoine.
« Tu
ajoutes, par tes travaux, à notre talent musical à tous les
deux. »
Joseph Haydn
« Bonne
et heureuse chose pour la musique si Pleyel est en état de
nous remplacer Haydn. »
Wolfgang Amadeus Mozart
Vienne, 24 avril 1784

IGNACE PLEYEL
Compositeur, éditeur, facteur de pianos
Autant en emporte le vent… et
l’histoire. Si le nom de Pleyel est aujourd’hui
universellement connu, il le doit bien plus à la production
de ses pianos qu’à ses compositions musicales. Sa notoriété,
si immense soit-elle au début du XIXème siècle, ne laisse
rien présager d’une telle destinée ; d’autant qu’au
contraire de ses futurs confrères, Ignace Pleyel ne vient ni
des métiers du bois, ni de celui des instruments de musique.
Un parcours atypique, l’exception qui, dit-on, confirme la
règle.
Son talent pour l’écriture
musicale lui assure une grande célébrité, « presque autant
que Haydn » nous dit un contemporain, et sa production,
assez importante en quantité, se compose essentiellement de
musique instrumentale mais aussi vocale et théâtrale.
Quelques unes de ses œuvres sont toujours publiées et
jouées, notamment celles pour petits ensembles et orchestre.
On lui doit entre autres plus de 40 symphonies, des
quintettes, une cinquantaine de trio avec piano, violon,
flûte, etc … des duos pour violon, 6 symphonies
concertantes, environs 60 quatuors à cordes, et 2 opéras :
Ifigénia in Aulide ( représenté à Naples en 1785 ) et Die
Fee Urgele ( pour marionnettes ). Notons (serai-ce la
ressemblance de style ?) que deux de ses trios ont été
longtemps attribués à Haydn (Hob. XV. 3 et 4). Sa méthode de
piano (1797) a été souvent rééditée.
Ignace Joseph Pleyel naît le 18 juin
1757 à Ruppersthal, en Basse-Autriche, une petite
localité située au nord- ouest de Vienne. Son père Martin
Pleyel, un modeste maître d’école, aura après deux mariages
(Quelques rares récits font état de trois mariages. Il
est probable que la vérité se situe à deux),
38 enfants et meurt quasi-centenaire
Ignace en
est le 24ème, sa mère perdant la vie en le
mettant au monde. Celle-ci, Anne-Thérèse ( ?) était de
famille très noble mais déshéritée à cause de sa
mésalliance. Cela n’empêcha point le jeune Ignaz, tout en
montrant très tôt des capacités intéressantes pour
l’écriture musicale (Johan-Baptist Wanhal (1739-1813) fut
son premier professeur. Il écrivit deux opéras ainsi que de
la musique de chambre) de trouver un protecteur, en
l’occurrence le Comte Ladislas Erdödy (en 1772). Ce dernier
le mettra pour cinq ans et à ses propres frais (pour 100
louis par an), en pension à Einsenstadt, chez Joseph Haydn,
le maître de l’époque qui en fera son élève le plus célèbre
(Haydn et Erdödy initièrent le jeune Pleyel aux pratiques
de la loge maçonnique Zum goldenen Hirschen). Présenté à
Gluck en 1776, celui-ci lui aurait dit, après avoir écouté
une de ses compositions : « Mon jeune ami, maintenant que
vous avez appris à mettre des notes sur le papier, il ne
vous reste plus qu’à apprendre à en effacer. »
Puis vint
(comme il se doit à l’époque) la période de l’initiatique
voyage en Italie, voyage de la consécration espérée ou en
tout cas d’une certaine reconnaissance. En vérité, il en
fera plusieurs, à Naples et Rome essentiellement. Là il y
rencontrera les plus grands compositeurs et musiciens du
moment. Présenté au roi Ferdinand IV, il lui écrira quelques
pièces pour une sorte de vielle à roue (Certains récits
évoquent une sorte de lyre). C’est certainement à
l’occasion d’un de ces séjours que lui est faite la
proposition d’assister le maître de chapelle Franz-Xavier
Richter (François-Xavier Richter (Holleschau, Moravie,
1709-Strasbourg 1789 de l’école de Mannhein a laissé des
œuvres remarquables dont 68 symphonies, des compositions
pour ensembles à cordes et beaucoup de musique religieuse) à
la cathédrale de Strasbourg. En acceptant, il obtient le
droit de bourgeoisie. Dès lors, Ignaz l’autrichien devient
Ignace, citoyen français.
C’est à
Strasbourg que Pleyel connaîtra l’apogée de sa carrière
créatrice (il signa en 1786 l’un de ses plus importants
contrats avec l’éditeur parisien Imbault. De ses
rapports d’affaires avec ce milieu très particulier,
certains s’avérèrent plus ou moins chaotiques, à se terminer
parfois dans les prétoires). Il y compose la majorité de
ses œuvres et peut-être, comme l’affirme plusieurs
historiens, la musique de « La Marseillaise ». (Il écrit en
1791 la musique d’un « Hymne à la liberté » sur des paroles
d’un de ses ami, Rouget de l’Isle. Avons-nous à ce sujet un
confusion ou une relation ? Nous savons seulement que notre
hymne national est écrit suite à une commande du jour même,
dans la nuit du 24 au 25 avril 1792, époque ou Pleyel
séjourne à Londres. Puis, il sera imprimé de mai à août sans
nom d’auteur…).
En 1783, il
prend la direction de l’école de musique du Cardinal de
Rohan, et dirige à partir de novembre 1786 avec J.Ph.
Schoenfeld le Concert public des Amateurs à la salle du
Miroir.
Le 22 janvier 1788 il épouse Gabrielle
Lefevre
(Fransiska, Gabrielle, Ignata Lefevre 1786- ?,
fille d’Etienne Lefevre, tapissier-ébéniste et de Marie
Gabrielle Peyre. Chez eux, à Strasbourg, Ignace aurait conçu
les plans d’un pianoforte)
qui lui donnera quatres enfants :
deux garçons, Camille et Gabriel, puis deux filles, Virginie
et Eugénie.
Nous voici
déjà en 1789. François-Xavier Richter décède le 12 septembre
et c’est dans l’ambiance délétère que l’on imagine qu’Ignace
prend sa succession comme maître de chapelle de la
cathédrale Notre-Dame. Ses compositions religieuses du
moment auraient d’après Fétis (François-Joseph Fétis,
Bibliographie universelle des musiciens en dix volumes,
Paris, œuvres rédigée de 1835 à 1844. Fétis, Mons
1784-Bruxelles 1871), était professeur et bibliothécaire au
conservatoire de Paris, puis maître de chapelle du roi de
Belges et directeur au Conservatoire royal de Belgique. Il
composa des œuvres pour piano, de la musique de chambre et
religieuse, des opéras-comiques etc… mais passera à la
postérité pour ses traités et importants travaux de
musicologie) disparu dans un incendie.
« Libéré »
rapidement de ses fonctions, il ne tarda pas, comme
beaucoup, à mettre le « Channel » entre sa personne et sa
patrie d’adoption (il restera en Angleterre de décembre
1791 à mai 1792).
A Londres,
il reçoit plusieurs invitations pour diriger des concerts. A
cette époque, l’actualité musicale de la capitale
britannique est nourrie (pour ne rien dire enflammée) par
deux organisations de concert rivales : le Professional
Concert de W.Cramer (le père de J.B. Cramer), et le Symphony
Concert du violoniste Salomon (1745-1815). Cette dernière
ayant (pour la deuxième année consécutive) engagé Haydn, le
professional Concert choisit Pleyel. Se retrouvant malgré
eux en compétition, le maître et l’élève ne se fâchèrent
point, laissant sur leur faim tous ceux qui prédisaient la
rupture d’une longue amitié. « Nous partageons notre gloire
également, et nous retournerons contents chacun chez soi »
écrit Haydn.
Les succès
des concert de Londres font une grande publicité tant aux
artistes qu’aux compositeurs… et sont très lucratifs (selon
la tradition, les bénéfices du dernier concert de la saison
revenaient au compositeur. Il pouvait, en une seule soirée,
gagner une somme importante, représentant jusqu’à une fois à
deux fois le salaire moyen annuel de l’époque). De
retour en France, Pleyel achète le château d’Itenwiller, un
ancien prieuré sis près de Strasbourg. Sûrement est-ce là
que germent en lui de nouvelles velléités ; peut-être même y
fait-il ses premières armes en tant que vendeur de pianos.
Frédéric de la Grandville (bibli.20) écrit : »… à cette
époque, Jean-Baptiste Erard envoie des pianos au
compositeurs Pleyel, comme le piano carré n° 2 604, vendu le
20 avril 1793 au Citoyen Pleyel à Strasbourg, (source :
registres de la fabrication Erard), ce dernier faisant
probablement office de vendeur avant de fonder sa célèbre
firme à Paris en 1805. »
Mais nous
sommes à cette date dans l’une des périodes les plus
troubles de l’histoire de France, entre la première et la
deuxième Terreur.
Accusé
d’hostilité aux nouvelles idées et de sympathie envers
l’aristocratie, le pauvre Ignace se voit obligé pour
échapper à la guillotine de se mettre en conformité avec les
nouvelles autorités : il sauvera sa tête par la composition
d’un « Toscin allégorique » ou « la Révolution du 10 août
1792 », une œuvre descriptive aux réminiscences de « ça
ira » et d’autres chants populaires, avec chœurs, salves
d’artillerie et le triomphe du peuple.
Il décidera
donc, après cet épisode pour le moins tourmenté, de vendre
son château et de partir s’installer à Paris, dans le
quartier de la Chaussée d’Antin. Nous sommes en 1795. C’est
plus précisément au mois de mars 1795 que Pleyel s’installe
définitivement dans la capital. Il ouvre une modeste
boutique de musique et d’éditions au 13, rue Neuve des
Petits Champs et commence par publier quelques une de ses
œuvres puis celles de ses confrères, Haynd bien sûr, dont la
collection complète de ses quatuors, Mozart, Méhul,
Beethoven, Boccherini, Dalayrac, Hummel, etc… Le premier, il
a l’idée de lancer dès 1802 une collection en format de
poche, la « Bibliothèque Musicale », au pris plus
avantageux.
Les ouvrages
historiques n’apportent que peu d’éléments sur les
circonstances l’ayant amené à passer du statut de
compositeur à celui d’éditeur puis facteur de piano. Son
renom est alors à l’apogée et on peut penser qu’à chaque
fois, il mettra de tout son poids cette réputation dans la
balance. Un almanach de musique sort en 1795 à
Saint-Pétersbourg, présentant quatre biographies de
compositeurs, et faisant part belle à Pleyel, au milieu de
Mozart, Haynd et Bach. Son portrait figure même au
frontispice du volume. On peut penser que ses relations
musicales d’Outre-Manche, notamment son ami Muzio Clementi,
lui-même éditeur à Londres, ne sont pas étrangères à ‘idée
de donner à sa carrière une orientation nouvelle. On sait
qu’à l’époque l’imprimeur, qui utilise des caractères
d’imprimerie, est soumis au « privilège royal » alors que le
métier d’éditeur est entièrement libre. L’entreprise demeure
cependant plus risquée et s’avère plus ou moins lucrative.
Nous devinons que celle-ci ne donnera pas les résultats
escomptés.
L’édition
présente certaines particularités comme celle d’être
tributaire de la mode…et la mode de l’éphémère ! La revue
Pleyel n°46 de juillet 1927 publie un article de ch.Van Den
Borren qui, à travers des « Souvenirs bruxellois de la
famille Pleyel », nous offre quelques précisions :
« Ayant
eu l’occasion, récemment, d’examiner de près une importante
collection de programmes de concert appartenant à la
bibliothèque du conservatoire de Bruxelles, j’ai été
particulièrement frappé par les fluctuations du goût musical
dont sont parfois victimes les artistes de valeur. Parmi ces
derniers, Ignace Pleyel (1757-1831) est à coup sûr l’un de
ceux auxquels on pourrait justement appliquer les termes de
« grandeurs et décadence ».

Il est
incontestable que, vers 1800, il est le musicien le plus à
la mode dans toutes l’Europe occidentale. Producteur fécond,
éditeur de ses propres œuvres à partir de 1745, il encombre
le marché international de ses innombrables sonates,
quatuors, symphonies, etc… comme le dit fort justement
Riemann, sa musique était de celle qui se vendait le mieux,
parce qu’elle répondait le plus parfaitement au goût moyen
du public.
Remarquons que ce goût n’était pas mauvais. Sans doute
Pleyel a trop d’abondance, de facilité ; il travail plus en
surface qu’en profondeur ; ses développements sont faibles.
Mais il a de l’invention, de la verve et on ne peut guère
lui reprocher d’être monotone ou ennuyeux. Il a été le plus
grand vulgarisateur de Haydn et de Mozart, qu’il a pratiqué
non sans grâce et avec une tendance somme toutes très
modérée à l’affadissement.
Il y a
encore, chez lui, beaucoup de cette veine aristocratique du
XVIIIème siècle, pleine de finesse, de légèreté et
d’enjouement, et s’il ne hante point les hauteurs auxquelles
ont accédé ses deux compatriotes autrichiens, il n’en a pas
moins contribués à donner, aux dilettantes de la période
révolutionnaire, la saine illusion d’un art qui n’était
point de pacotilles, et auquel on ne peut faire aucun
reproche de vulgarité…
…L’année
1800 paraît avoir été, partout, la plus glorieuse pour notre
musicien. Trois programmes bruxellois de cette saison font
allusion à lui…
…Le 22
novembre 1800 (1er frimaire, an IX)…Pleyel d^y
affronter la concurrence de Haydn, dont on interpréta un
andante, une symphonie, et « la Création », depuis le chaos
jusqu’après l’apparition de la lumière, autrement dit, le
premier jour de la Création du Monde. L’étoile bruxelloise
de Pleyel pâlit-elle devant cette « lumière » ? Toujours
est-il que pendant trois ans, le nom du grand favori 1800
n’apparaît plus dans notre collection de programmes …
Suivent
seulement deux concerts, fin 1803 et le 28 janvier 1804, où
sont jouées deux symphonies.
... puis
plus rien jusqu’en 1809. On dirait que l’oubli commence à
étendre ses voiles sur l’œuvre aimable du trop abondant
Ignace. Et il en est bien ainsi : car, si l’on met à part la
symphonie exécutée le 9 janvier de cette année et celle
donnée le 15 janvier 1810, aux concerts de la Société des
Amateurs de Musique, plus jamais, dans la suite, son nom ne
reparaîtra sur les programmes des auditions musicales
bruxelloises.
La mode,
impitoyable, a rendu son verdict. C’en est fait de ce
classicisme agréable et léger, de cet écho affaibli du
XVIIIème siècle élégant et frivole. Ce qu’exige maintenant
le goût moyen, c’est une virtuosité plus excitante et des
inflexions plus molles, mieux en accord avec les aspirations
sentimentales du préromantisme bourgeois. »
L’avènement
du siècle nouveau représente assurément un virage important
dans la carrière de notre compositeur.
On relève, à
l’époque, un prêt consenti par Méhul aux époux Pleyel. Il
semble, qu’en ce qui concerne leurs rapports financiers, ce
prêt de dix mille livres soit le seul concédé par l’auteur
du très patriotique Chant de Départ. Il devait, d’après les
historiens, aider Ignace à monter sa manufacture de pianos.
Or, la date ne colle pas : ce prêt est contracté le 16
messidor an 8, ce qui correspond au 5 juillet 1800. Nous
pouvons en déduire que Méhul n’a aidé Ignace Pleyel qu’à
l’époque où il était éditeur. Cela confirmerait l’état de
santé relativement précaire de la maison d’éditions Pleyel ;
mais pourrait aussi démontrer le côté visionnaire de notre
homme, envisageant déjà autre chose. N’oublions pas qu’il a
pu, depuis sa période alsacienne, goûter au négoce
d’instruments ou d’accessoires. Et dans ce contexte
n’avait-il pas, alors qu’il créait en 1802 sa fameuse
collection en format de poche, la tête ailleurs ?...
Effets de
mode et désaffection du public ont, de toutes façon, incité
Ignace à insuffler un vent nouveau à sa carrière musicale.
De là à envisager une association avec un facteur de pianos,
il n’y a qu’un pas relativement facile à franchir. Bien que
n’étant pas de la partie, il tentera tout de même
l’expérience avec Charles Lemme (pour peu de temps). Quand
au doit disant concours du facteur de pianos Henri Pape,
nous allons en reparler. En tout état de cause et comme nous
dirions aujourd’hui, il savait rebondir.
Rapidement,
donc, Pleyel étoffe ses activités d’éditeur par la vente
d’instruments divers, notamment les harpes, les cordes et
les pianos. En 1809, de plus en plus impliqué dans son
entreprise de fabrication, il se décharge des affaires de
l’édition en nommant un mandataire. Il tentera aussi, au
moment de ses problèmes financiers de 1803, de vendre sans
succès cette partie de son patrimoine.
Cette vente
se réalisera toutefois, mais bien plus tard, en juin 1834,
presque trois ans après sa mort (notons qu’une partie de
cette vente échoua à Prilipp (et non Prelipp, comme on voit
souvent écrit), celui fut, avec Baumgarten, parmi les
meilleurs ouvriers d’Allemagne embauchés par Pleyel dès le
début, vers 1807-1808, nous pouvons définir son cursus comme
inverse à celui de son employeur : issu de la facture du
piano, il finit sa carrière comme éditeur. Pour notre
part nous pensons qu’il s’installe comme facteur de pianos
indépendant entre les années 1815 et 1820, et plus
concrètement, nous relevons quelques indications dans
l’agenda Musicale de 1836 réimprimé chez Minkoff, Genève,
1981 : on le trouve encore à la rubrique des facteurs de
pianos, au 31, rue de Clichy en 1835, et au 35 rue, de la
Chaussée d’Antin les deux années suivantes. Ce n’est qu’à
partir de 1836 que son nom apparaît chez les éditeurs :
Prilipp et Compagnie, acquéreurs d’une partie du fond d’I.Pleyel.
). D’ici là, la maison Pleyel aura adapté son catalogue
à la demande croissante de musique plus légère et édité, à
travers près de trois mille titres, des fantaisies,
chansonnettes et autres romances.
Constant
Pierre, musicologue et secrétaire adjoint au conservatoire
de Paris vers la fin du siècle (bibl.13), nous dit qu’après
avoir fourni une brillante carrière comme compositeur et
éditeur de musique, Ignace Pleyel prit la résolution de
s’établir facteur de pianos, à l’âge de 50 ans. Un domaine
qui lui était étranger.
Nous
retrouvons régulièrement dans les écrits ces mêmes termes :
« un domaine étranger… étranger aux affaires… »
Il semble
qu’Ignace soit resté un artiste toute sa vie. Mais,
conscient des énormes problèmes liés à la gestion et surtout
à la fabrication, il s’associe rapidement, en bonne
intelligence, avec un facteur de pianos, Charles Lemme et,
affirment les historiens… Henri Pape plus tard. Nous devons,
au sujet de cette dernière collaboration rester très
prudents : rien en effet ne prouve que Pape et Pleyel ont
travaillé ensemble. La plupart des ouvrages spécialisés
réitèrent depuis des décennies ce qui pourrait n’être qu’au
départ qu’une pure invention, ou à la limite, une
extrapolation infondée. Tous voient Pape entrer chez Pleyel
vers 1810, et pour certains en devenir le directeur en 1815.
Nous préférons à ce sujet (et jusqu’à preuve du contraire)
suivre Catherine Michaud-Pradeilles qui a consacré sa thèse
de musicologie à Pape. Elle pose réellement la question
(bibl.20) : « que fit-il durant les six premières années
passées à Paris ? La légende veut qu’il soit allé chez
Pleyel. En réalité, Pape fit quelques aller et retour en
direction de Londres sur les traces d’Erard, dont le retour
définitif en France ne se situe qu’en 1815 ».
Collaboration ou pas, profitons de l’occasion pour consacrer
quelque lignes à ce contemporain d’Ignace et Camille Pleyel.
Johan Heinrich pape, né à Sarsted (Hanovre) le 1er
juillet 1789, mort à Asnières le 2 février 1875, fut le plus
inventif de nos facteurs de pianos. Il est connu pour avoir
déposé 137 brevets dont beaucoup ne furent pas suivis. Sur
les 73 exclusivement destinés à la facture du piano, on
retiendra ceux toujours appliqués des têtes de marteaux en
feutre (1826), et des cordes croisées (1827).
Il
s’installera vers 1817. Là aussi, nous avons trop peu de
renseignements : nombre d’ouvrages situent la création de sa
propre fabrique entre 1815 et 1818… Pape se fera remarquer
par diverses constructions d’inégales utilités : le piano
console d’un mètre de hauteur, un système mécanique de piano
à queue avec les marteaux au-dessus des cordes (1827-1835),
le piano sans cordes (celles-ci étant remplacées par des
lames métalliques), mais aussi celui avec un double montage
des cordes pour obtenir un contre tirage, le piano à deux
tables d’harmonie reliées par une âme, le piano table, le
piano rond, ovale, hexagonal, etc… Il obtint diverses
récompenses, dont plusieurs médailles d’or de 1823 à 1851.
Aussi
bizarre que cela puisse paraître, les historiens ont plus
souvent signalé cette collaboration Pape Pleyel, aujourd’hui
supposée fausse, que celle bien réelle avec Charles Lemme.
Charles
Lemme, originaire de Braunschweig (1769-1832) fabrique déjà
des clavicordes et des pianofortes quand il s’installe à
Paris en 1799. Son association avec Pleyel durera peu de
temps, officiellement du 1er décembre 1805 au 25
février 1808, en réalité moins. Ignace apporte l’argent,
Lemme son savoir-faire. C’est Alain Roudier, par son ouvrage
(bibl.17), qui nous apporte toute ces précisions. On apprend
aussi que Lemme produit régulièrement jusqu’à la fin des
années 1820, et qu’il est l’auteur d’une nouvelle Méthode de
musique et gammes chromatiques. Une très rare production
commune, signée des deux hommes est un piano carré à huit
pieds, six pédales et 5 octaves ½. Il porte le n°2360 et est
disposé sur une petite estrade. Cet instrument
magnifiquement décoré a sûrement fait l’objet d’une commande
spéciale. Il trône actuellement au sein d’une collection
espagnole.
C’est donc
fin 1807, avant même que la dissolution de son association
avec Lemme soit prononcée, que Pleyel s’installe dans ses
propres ateliers. Ces débuts seront difficiles et nous
pouvons penser que la grande maison Pleyel n’aurait jamais
existé sans l’aide et l’apport financier d’amis musiciens et
surtout l’arrivée de son fils Camille aux affaires. Nous
verrons cela plus loin.
Son épouse
était contre ce qu’elle appelait « un nouveau caprice ».
Elle essaya de l’en dissuader :
« Crois-moi,
mon ami, lui écrit-elle, au lieu de tous ces pianos, harpes
etc…, nous ferions bien mieux de graver toutes sortes de
petites œuvres demandées tous les jours, qui n’exigent pas
de grandes avances et dont la rentrée est sûre. »
Constant
Pierre rappelle ces débuts :
« … et fonda
en 1807 sa célèbre manufacture de pianos. Les premières
années de sa nouvelle exploitation n’offrent rien de
saillant, c’était la période d’organisation. Etranger à la
facture, Ignace Pleyel trouva dans son fils Camille (né à
Strasbourg le 18 décembre 1788), un auxiliaire actif et
expérimenté qui lui succèdera en 1824. »
Le 13
juillet 1813, il écrit à son fils : « Les affaires vont
extrêmement mal, je ne voit personne pour acheter, je n’ai
vendu ni pianos, ni harpes, même pas une pauvre guitare…j’ai
quarante pianos tout prêts à livrer et personne n’en achète.
Je crois que mes pianos ne seront connus et estimés qu’après
ma mort. » Le commerce souffre énormément au début du
XIXème. On ne compte plus les faillites et les
liquidations. Pleyel met sept ans à se relever d’une telle
situation. Au même moment, son grand concurrent Erard
connaît similaire mésaventure.
Ignace
Pleyel devra son salut à quelques amis, notamment
Kalkbrenner et Rossini. Leur générosité permet à la maison
Pleyel de repartir. Elle n’avait fabriqué jusque-là que
quelques dizaines de pianos par an.
De plus, ces
périodes d’inventions, de perfectionnements, suscitent bien
des ambitions. Par l’évolution des techniques, le
machinisme, et le goût nouveau pour le piano carré, le
nombre des facteurs de pianos passe d’une poignée en 1800 à
une trentaine en 1820 pour atteindre le record jamais égalé
de 200 en 1850. Aujourd’hui il n’en reste qu’un : Pleyel,
justement, dont l’usine est à Alès, dans le gard.

Le « flou pianistique »
On ne sait exactement combien de pianos ont
été construits par Ignace Pleyel. Nous nous arrêterons plus
loin de façon arbitraire au nombre de 900 pièces en 1827.
Ces chiffres sont les premiers que nous fourniront les
archives, mais nous pensons qu’il s’en produisit moins.
Cette période du début que nous qualifions gentiment de
« flou pianistique » ne voit, à part un brevet d’importation
pour des procédés « de fabrication des cordes en cuivre et
en fer » (novembre 1810), aucune innovation remarquée.
Les pianos, par principe,
sont tous numérotés, mais nous aurons l’occasion, en
vérifiant, de constater d’énormes décalages. Les
professionnels disposent de tableaux de datation. La plupart
annoncent les numéros 760 en 1810, 1420 en 1815, 2100 en
1820 etc… Nous verrons dans le deuxième chapitre que cela
est faux.
On supposera une baisse de
production dans les années 1818-1824. La France connaît à ce
moment-là un climat social des plus moroses. Commencent à
cette époque des migrations importantes. Les épidémies, les
mauvaises récoltes délogent les paysans des campagnes. De
pauvres hères envahissent des villes accentuant l’insécurité
et l’insalubrité. Les prix, mais aussi les salaires
baissent. Pendant que Napoléon va mourir à Sainte Hélène,
notre pays tente de s’organiser. Il lui faudra attendre les
règnes de Charles X et surtout de Louis Philippe pour voir
les premiers signes avant-coureurs d’essor industriel et
social.
Méhul enfin, qui l’avait
aidé financièrement au début du siècle, décède en 1817. Cela
entraîna l’obligation de rembourser prématurément une
importante somme d’argent et freinera les projets d’un
Ignace Pleyel déjà sexagénaire. A partir de ce moment là,
son fils aîné Camille délaissera les concerts et la
composition pour s’impliquer de plus en plus dans l’affaire
familiale. Il sera aidé en cela par le grand pianiste
Kalkbrenner.
FREDERIC KALKBRENNER
Eminent pianiste, reconnu
et même adulé en son temps, Kalkbrenner est indissociable de
l’histoire de la maison Pleyel. Nous évoquerons son nom à
plusieurs reprises dans cet ouvrage.
Né entre Kassel
et Berlin début 1785, Friedrich Wilhelm Michael Kalkbrenner
commence l’apprentissage de la musique avec son propre père
(son père, Christian Kalkbrenner, (Minden,
22/09/1755-Paris 10/08/1806), choriste et violoniste, fut le
maître de chapelle du Prince Heinrich à Rheinsberg (de 1790
à 1796). A partir de 1799, il dirigea le chœur de l’Opéra de
Paris.) puis se perfectionne au gré de ses voyages en
Europe. Peu après son premier prix de piano de d’harmonie à
Paris en 1801 (élève de J.L Adam et Catel), il côtoie Haydn
et Clémenti (1803-1804), dont il gardera une certaine
influence sur son jeu et sa méthode. Partagé entre concerts
et leçons, il s’installe à Paris dès 1805. Son étoile
brillera à Naples, Vienne, Londres (où il s’établit entre
1814 et 1823). On ne compte plus alors les dames de la haute
société à revendiquer le titre d’élève de Kalkbrenner.
C’est vers 1824 après une
tournée triomphale de concert en Allemagne en compagnie du
harpiste Dizi, qu’il s’associe avec Pleyel. Il ne se
consacre plus dès lors qu’au piano, sa facture, et surtout
son enseignement (il abandonnera les concert vers 1835).
Ses compositions, dans
l’air du temps, tomberont dans l’oubli. Des sonates et
concertos, des duos, trios, quatuors, etc… On peut toutefois
retenir ses préludes op.88 d’un style très proche de celui
de Chopin. A noter également le piano avec le « guide
mains », un système de son invention plutôt critiqué : « …
l’enfant, s’appuyant sur une pièce fixe et résistante,
(une traverse en bois, soutenant les avant-bras à hauteur
voulue), n’est astreint à aucun effort personnel : aussi,
lorsqu’on supprime l’appui auquel il est habitué, se
tient-il souvent aussi mal qu’auparavant. Son intention ne
mit pas en bonne renommée de son auteur » « D’après un de
ses biographes, propos repris par Raoul Brévannes, in « Musica »
n°89, février 1910.
Il crée également un
clavier muet pour l’apprentissage et l’exercice des
premières études.
Il y a les pros et les
anti-Kalkbrenner, comme il y aura les pros et les
anti-Chopin. Voici encore, issues du même journal et visant
son jeu aérien et gracile, quelques critiques soignées. Du
pur vitriol qu’il faut considérer ici comme un témoignage de
la mutation culturelle du temps :
« …il est le chef d’une
école de pianistes qui se recommandent par une minutie
d’exécution qui dégénère en mièvrerie. Pour nous, cet
artiste n’a jamais occupé qu’un rang très secondaire. Son
jeu, mou, efféminé, cotonneux, faisait les délices du beau
sexe, qui se pâmait à ses petits traits perlés, à peine
effleurés, et aux mines gracieuses, au sourire satisfait,
aux grâces penchées, déployées par le virtuose, le tout mêlé
à une allure vulgaire et à un ton cabotin qui faisaient
justement dire de lui par Koreff qu’il avait l’air d’un
bonbon tombé dans la boue. La vigueur et l’accent lui ont
toujours fait défaut. Pianiste pour dames, de même qu’il est
des cordonniers pour dames, voilà tout ce qu’a été
Kalkbrenner »
Frédéric Kalkbrenner décède à
Enghien-les-Bains en 1849. il laisse un fils, Arthur
(1828-1869), virtuose et compositeur distingué, qui a
notamment écrit un opéra : l’Amour (Arthur Kalkbrenner
n’est que peu cité dans l’histoire de Pleyel. On le trouve
cependant comme commanditaire avec un certain Edouard
Rodriguès au moment où Auguste Wolff rentre dans la société
pour s’associer à Camille Pleyel le 1er février
1853 (bibl.17, page 26), et également en 1864 dans la
société en commandite « Pleyel, Wolff et Cie »).
CAMILLE PLEYEL
Camille, Joseph, Stephen
Pleyel, naît le 18 décembre 1788 à Strasbourg. Tout d’abord
élève de son propre père, il est ensuite formé par Dussek
(1760-1812). Il s’adonne à la composition avant de se
révéler excellent musicien et concertiste. « il n’y a
plus aujourd’hui qu’un homme qui sache jouer Mozart, c’est
Pleyel, et quand il veut bien exécuter avec moi une sonate à
quatre mains, je prend une leçon » (F.Chopin). on lui
doit trois trio, quelques sonates, rondos et nocturnes, des
variations etc… Intéressé aux affaires des 1813 – par
procuration du 25 mai, il est nommé mandataire de son père
pour l’ensemble de ses activités commerciales (bibl.17) – il
entreprend de nombreux voyages et tournées de concerts (on
sait , pour l’anecdote, qu’il expédia à l’occasion d’une ou
plusieurs de ses tournées, du vin de Bordeaux à son père qui
le revendait dans sa boutique d’édition.). Il observe la
production des facteurs en vogue à ce moment-là et chez
Broatwood à Londres, dont il apprécie la facture, il retient
les derniers perfectionnements de l’échappement anglais
qu’il adoptera plus tard pour ses pianos.
Il rejoint son père aux
affaires pour, avec son accord, entamer une période de
réorganisation de l’entreprise. Nous sommes en 1824. Il a
alors 35 ans et son père 67. nous insistons sur cette
période car nous pensons que Camille a mis la véritable
manufacture Pleyel à partir de 1825 et qu’une nouvelle
numérotation ait pu être mise en place à cette époque (cela
s’est déjà vu chez d’autres facteurs). Nous verrons plus
loin si nous avons raison ou tort, et tenterons un essai de
datation pour la période qui nous intéresse.
Camille Pleyel donnera un
indispensable essor à sa manufacture grâce à ses travaux de
recherches et d’innovations, à ses capacités de
gestionnaire, à ses relations aussi. Ses rapports entretenus
avec les grands musiciens de l’époque lui seront d’un grand
secours. Kalkbrenner surtout qui avait déjà aidé son père en
1813 et qui, comme on vient de le voir, deviendra son
associé, Cramer, Moscheles, steibelt également, mais le plus
connu est Frédéric Chopin qui jouera à Pleyle de 1832 à 1848
et fera une énorme réclame pour la maison.
On cite souvent un concert
célèbre en 1835, où cinq virtuoses jouèrent ensemble. Ce
furent, avec lui : Henri Herz (facteur de pianos depuis
1825), Ferdinand Hiller, Osborne et Stamaty, le futur maître
de Saint-Saëns. Il faut ajouter, dans ce Paris en pleine
émancipation musicale, la femme de Camille, Marie, née moke,
« gracieux Ariel » de Berlioz (Marie, Félicité, Denise
Moke (Paris, 04/09/1811, Saint-Josse-Ten-Noode, près de
Bruxelles 30/03/1875) sera fiancée quelques temps à
Berlioz.Un rôle bref et ambigu dans une période agitée du
compositeur qui courait après son prix de Rome. C’est en
obtenant enfin cette consécration qu’il apprit la trahison
de celle qui lui « chassait le feu de l’enfer dans le
sang ». Camille Pleyel et Marie Moke se marièrent le au
printemps 1831, mais se sépareront quatre ans plus tard.
Elle reprendra alors ses séries de concerts, puis enseignera
de 1848 à 1872 au conservatoire de Bruxelles. Elle donna
deux enfants à Camille : Henry (1832-1853) et Louise
(1833-1856). Tous deux sont décédés sans successions.),
virtuose accomplie et concertiste réputée dans toute
l’Europe.
Camille Pleyel sort dès
1825 le piano unicordes (une corde par note sur tout ou
partie de l’instrument). Plus tard, il perfectionne le
sommier d’accroches et s’interresse aux désagréments subis
par les cadres bois, notamment la trop forte tension des
cordes (brevet du sommier dit « prolongé » en 1828). Il
essaie plusieurs systèmes de renfort, de barres métalliques.
Celles-ci sont placées, selon les périodes et les modèles,
devant et/ou derrière la table d’harmonie. (Bien qu’inventé
en 1825 par l’américain Babcok, le cadre métallique coulé
d’une seule pièce ne sera monté en série par les facteurs
français que vers la fin du siècle. Nous y reviendrons).
A noter son brevet de
placage à contre-fil de la table d’harmonie (1830). D’un
point de vue déontologique, les facteurs de pianos se sont
toujours refusés à admettre et à appliquer cette méthode…
jusqu’à nos jours. Nous constatons en effet depuis une
vingtaine d’années, la fabrication de plus en plus fréquente
de tables d’harmonie en trois plis. Pour le moment, nous
pouvons dire que la sonorité n’en pâtit pas et que la
résistance aux méfaits des conditions hygrométriques
(dessèchement), en semble accrue. Le 14 avril 1829, les
Pleyel père et fils règlent les affaires de succession en
fondant avec Kalkbrenner la Société « Ignace Pleyel et
Compagnie ». Nous observons que Camille n’a jamais tenté de
se faire un prénom. Nous n’avons jamais vu de piano
« Camille Pleyel » (une société « Camille Pleyel et Cie »
est créée en 1829. elle concerne que la fabrication et la
vente des harpes. A noter que le brevet 1830 de placage à
contre fil résulte des travaux entrepris par le pianiste
François Dizi pour cet instrument.). « Ignace Pleyel et
Compagnie » avait pour raison sociale la gestion, la
fabrication, la vente et la location des pianos. Un second
acte de société concerne uniquement la partie d’éditions
musicales. Kalkbrenner sera associé financièrement dès ce
moment à toutes les opérations menées par la maison Pleyel,
et ce jusqu’à sa mort en 1849.
Parmi les investissements d’envergure,
citons l’achat en 1843 de terrains rue Rochechouart qui
accueilleront plus tard de nouveaux bâtiments pour la
fabrication et l’exposition ainsi qu’une salle de concert.
Pour ce faire, Camille vendra en juin aux enchères, le
commerce d’éditions musicales. Les principaux acquéreurs
seront Richault, Lemoine, Prilipp (cf.p.31), Guillaume… on
sait qu’Ignace ne verra jamais ce projet se réaliser, mais
il aura la satisfaction cinq mois avant sa mort, de savoir
l’avenir de sa maison assuré et assisté au mariage de son
fils. Dès les années 1830-35, Camille veut gagner une
nouvelle clientèle. Il s’essaye au marché international
jusqu’ici dominé par les anglais. Par force modifications
pour s’adapter aux contraintes climatiques et aux soins
apportés à la fabrication de ses pianos, il réussit à
s’implanter aux Indes, en Australie et aux Amérique. La
maison Pleyel reçoit une médaille d’or en 1827 pour sa
première participation à une exposition. Suivront les mêmes
en 1834, 1839, 1844 et en 1855, une médaille d’honneur à
l’exposition universelle de Paris. Une juste récompense que
Camille ne savourera pas : il décède le 4 mai.
Voici ce qu’écrit le
journal d’illustration un mois plus tard, le 9 juin :
« il ne faut pas s’étonner que la
moitié des pianos de la fabrication Pleyel soit répandue en
Italie, en Espagne, dans les deux Amériques du nord et du
sud, au Chili, au Pérou, dans l’Inde, et jusqu’en Australie.
C’est au milieu de ce succès industriel, à la veille même de
l’exposition industrielle, qui ne peut manquer de la
consolider en le confirmant, que M. Pleyel a été enlevé aux
amis choisis dont il avait su mériter l’estime, aux nombreux
et anciens ouvriers dont il possédait l’affection, qui
l’aimaient comme un père, qu’il encourageait de ses conseils
et de son exemple, et qu’il aidait dans les moments
difficiles, les soignant dans leurs maladies et les
associant en quelque sorte à ses dénéfices. »
Nous observons pour la première fois,
dans ces quelques lignes, les signes de bonnes relations
qu’essayait d’entretenir Pleyel avec ses ouvriers. Ces
nobles dispositions seront suivies par ses successeurs et
récompensées par une médaille d’or dans la section
d’économie sociale à l’exposition universelle de Paris en
1889. Nous en reparlerons.
GABRIEL PLEYEL
Bien qu’il soit hors sujet, nous avons
tout de même choisi de vous dire deux mots sur Gabriel
Pleyel.
On n’a trouvé aucune trace nous
permettant d’affirmer qu’il s’impliqua dans la facture
familiale. Considéré comme dissident, (il n’était pas en
meilleurs termes avec son frère aîné), il fit route à part,
tout seul d’abord, puis en association avec un nommé Pujol.
Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne marqua pas la
facture française de son empreinte.
Nous lisons quelques rares
renseignements dans l’ouvrage « Pleyel au temps de Frédéric
Chopin » (bibl.17) : « … puis s’associe avec un certain
Pierre Pujol le 21 février 1827. ce dernier, simple
commanditaire domicilié à Billy sur Aisne, apporte à la
société « Gabriel Pleyel et Cie » la somme de vingt mille
francs. Gabriel demeure à l’époque au n°42 rue des Martyrs à
Paris et reste le seul gérant et responsable de la société
jusqu’au 29 août 1832, date de sa dissolution ».
La production de Gabriel Pleyel fut
assez modeste. On peut observer dans l’ouvrage sus-cité deux
photos d’un piano droit n° 1137 à 2 cordes, oblique,
mécanique lames, chevilles plates. Nous ne connaissons à ce
jour que peu d’exemplaires en France, tant dans les
collections privées que publiques. Pas plus de trois dont le
n° 1439 au Musée du Piano de Limoux. On observe aussi sur ce
dernier, le numéro 178 (sur le sommier) et 11209 (sur le
côté), de quoi y perdre son latin ! Nous sommes là en
présence quasi-certaine d’une numérotation fantaisiste ;
peut-on imaginer que les numéros de 1 à 1000 ne sont jamais
sortis ?
Voici, toujours sur le piano de Limoux,
l’inscription complète marquée à l’encre sur la table
d’harmonie : « Pleyel et Cie Paris 1831, 1439 » (pas de
mention du prénom). Le meuble de forme lyre, est en bel
acajou flammé. Le clavier comprend 6 octaves ½, de do à fa,
la mécanique est à lames. Montage à 2 cordes par note. Les
appliques et les chandeliers ne sont pas d’origine. Nous
notons sur la planche d’adresse :
Gabriel Pleyel et Compagnie
Rue Vivenne Galerie Colbert n° 23 et 25
A Paris.
Pour en savoir plus sur la prestigieuse maison Pleyel nous
vous recommandons un livre très bien conçu dont nous avons
reproduit de nombreuses pages (Le Piano Pleyel d’un
millénaire à l’autre de Jean Jacques TRINQUES L’Harmattan)
L’Harmattan
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique
75005 Paris
FRANCE